Petites lectures du 1er semestre 2011
Sur les thèmes Communication, crise et environnement.
OCDE, Greening household behaviour. The role of public policy, OECD Publishing, 192 pages.
Un livre remarquable de précisions sur l’opinion publique environnementale dans les pays de l’OCDE et la manière dont les politiques publiques peuvent agir pour encourager le changement de comportement dans un sens plus écologique. Une grande masse de données réparties par thème comme l’usage de l’eau, les économies d’énergie, le traitement des déchets, les encouragements aux transports publics, les aliments biologiques. Chaque chapitre se termine par une courte synthèse mettant en évidence les implications pour les politiques publiques.
Edwin Zaccai, 25 ans de développement durable, et après, PUF, 238 pages.
Un ouvrage qui revisite 25 ans d’une notion complexe. J’y ai appris pas mal de choses comme le fait que la représentation en 3 pôles ne datait que de 1997, qu’un des apports de l’Europe avait été d’imposer les acquis de l’Union aux nouveaux entrants, qu’on retrouve des textes sur la croissance verte dès 1976, que la première charte industrielle sur l’environnement vient des entreprises chimiques canadiennes en 1985. L’auteur observe que le développement durable a été « carbonisé » par la survalorisation du problème climatique. Beaucoup de données intéressantes et de réflexions. On regrettera quelques erreurs factuelles.
Régis Debray, Du bon usage des catastrophes, Gallimard, 108 pages.
Un essai qui tente de revisiter nos grandes catastrophes au regard des religions et de plus de 2000 ans d’histoire. L’auteur explique que le besoin de faire sens est premier en période de crise et que le désir prophétique est toujours tacite. Un livre étrange où Régis Debray adresse quelques piques aux philosophes contemporains, explique la méthode pour devenir un grand intellectuel, et quel peut être le rôle de la médiologie. Pas son meilleur livre.
Nancy Fraser. Qu’est-ce que la justice sociale? Reconnaissance et redistribution. La Découverte / Poche. 180 pages.
Réédition de l’ouvrage antérieurement publié en 2005. Composé de 6 articles réunis, présentés et traduits par Estelle Ferrarese, l’ouvrage part de l’idée que «la justice implique à la fois la redistribution et la reconnaissance» et cherche à en analyser l’articulation. Partant de l’idée hégélienne de reconnaissance, Nancy Fraser indique que la justice n’est pas réductible aux inégalités économiques et examine les conceptions d’Axel Honneth et surtout celle de l’espace public d’Habermas. Selon elle, les luttes pour la reconnaissance deviennent centrales alors que les luttes égalitaristes deviennent marginales. Un livre exigeant et important.
Paul Jorion. La guerre civile numérique. Textuel. 110 pages.
Spécialiste des questions monétaires, Paul Jorion, auteur d’un blog célèbre – 100 000 visiteurs par mois – propose un petit livre d’entretiens sur la guerre civile numérique, autrement dit le recours au web et aux réseaux sociaux comme outil de déstabilisation. Il se concentre sur les révolutions arabes et Wikileaks et fait découvrir de nouveaux concepts comme l’astro turfing ou le honey pot.
Il indique aussi qu’aux USA les internautes passent plus de temps sur les réseaux sociaux que sur leur boîte mail. L’influence est moins dans les think tanks que sur le 2.0, selon l’auteur.
Un livre sans prétentions, synthétique, facile à lire.
Richard Thaler et Cass Sunstein. Nudge: La méthode douce pour inspirer la bonne décision. Vuibert. 278 pages.
Excellent ouvrage sur les pratiques visant des modifications de comportement. Ce livre m’a fait penser à celui de Joule et Beauvois (Guide de manipulation à usage des honnêtes gens) que j’avais dévoré en son temps. On peut traduire Nudge par coup de pouce, autrement dit le petit déclic, basé sur la psychologie des comportements, pour asséner une décision. Les exemples sur les progrès réalisés dans le comportement éco-responsable sont très intéressants. Je recommande.
Nicolas Bourriaud. Esthétique relationnelle. Les presses du Réel. 124 pages.
Définie comme une théorie consistant à juger les œuvres d’art en fonction des relations interhumaines qu’elles figurent, produisent ou suscitent, l’esthétique relationnelle place la communication au centre de ses analyses. Alors que l’espace social réduit et encadre les possibilités de relations interhumaines, l’art contemporain s’efforce d’investir et de problématiser cette sphère relationnelle. Participation du public, performances, happening, l’art devient échange et interaction et le spectateur devient partie prenante de l’œuvre. Une bonne lecture.
Aurore GORIUS et Michaël MOREAU. Les gourous de la com. Trente ans de manipulation politique et économique.La Découverte. 312 pages.
Un ouvrage bien documenté sur les grands noms qui font la communication. Si les informations sont nombreuses, l’ouvrage est surtout dénonciateur et s’attache principalement à la communication des dirigeants économiques et politiques et moins à celle des organisations. Les directions de communication des entreprises apparaissent étrangement oubliées. Trois personnages sont principalement ciblés dans le livre: A. MEAUX, M. CALZARONI et S. FOUKS. Quelques erreurs repérées.
Gilles Finchelstein. La dictature de l’urgence. Fayard. 228 pages.
Une dénonciation de l’accélération du temps, très documenté, qui analyse un grand nombre de champs où la vitesse fait ses ravages : la finance, le travail, les transports, l’hôpital et beaucoup d’autres. On a plus de mal à être convaincu par les propositions finales pour décélérer.
Damien Masset. Réussir ses projets événementiels. 3ème édition. Gereso. 121 pages.
Un excellent ouvrage, très pratique, comportant de très pertinentes fiches efficaces pour l’aide à l’élaboration et au pilotage d’un événement. Je regrette juste l’absence quasi-totale d’indication des réseaux sociaux dans la communication événementielle.







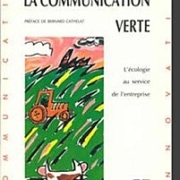


 Auteur de nombreux livres et articles sur l'Europe, la communication, l'environnement et les crises, Thierry Libaert est Conseiller au Comité Economique et Social Européen. Point de contact de la délégation française.
Auteur de nombreux livres et articles sur l'Europe, la communication, l'environnement et les crises, Thierry Libaert est Conseiller au Comité Economique et Social Européen. Point de contact de la délégation française.